Accepter la République et ses lois écrites fait de vous un citoyen. Mais apprendre les codes non écrits d’un peuple et y adhérer transforme les citoyens en membres d’une nation et en héritiers de plein droit du passé du peuple qu’ils rejoignent.
L’idée d’assimilation n’a pas bonne presse dans une époque qui valorise par-dessus tout le droit de chacun à suivre sa propre voie et, s’il est migrant, à cultiver ce qui le relie à sa société d’origine. Le sens même de la notion est mis en question dans des sociétés marquées par une grande diversité de choix de vie. Auxquels de ses membres, objecte-t-on, faudrait-il ressembler pour être déclaré « assimilé » ? En réalité, cette objection fait bon marché du fait que la diversité d’une société n’est pas infinie.
Trois manières de prendre place dans une société d’accueil
L’existence d’institutions communes, de lois communes, souvent d’une langue commune, d’éléments de mémoire largement partagés au sein d’une communauté nationale (la Révolution française, la guerre de Sécession), fait qu’en dépit de sa diversité interne, chaque société a quelque chose d’unique. Ainsi, selon les pays, l’encadrement des conduites de chacun est assuré d’une manière particulière, que ce soit par un pouvoir fort comme en Chine, par la pression sociale comme au Japon, ou par la loi comme en Europe occidentale. Les modalités permettant à des groupes qui vivent différemment de coexister de manière relativement pacifique divergent selon les sociétés : dans certains cas, comme aux États-Unis, les groupes vivent largement dans des lieux distincts ; dans les sociétés de castes, les rapports entre groupes sont minutieusement codifiés. L’existence d’une identité commune joue un rôle important quand il s’agit pour une nation d’agir en corps, comme en guerre. Tout ce patrimoine peut donner l’impression d’aller de soi pour ceux qui l’ont reçu en héritage dès leur plus jeune âge, mais peut paraître étrange à ceux qui viennent d’ailleurs.
Pour les nouveaux venus, trois grandes manières de prendre place là où ils jettent l’ancre sont possibles.
Une attitude courante consiste à se soumettre aux lois du pays d’accueil tout en continuant autant que possible, dans les domaines que ces lois ne régissent pas, à maintenir les traditions de sa société d’origine au sein d’une diaspora. Les liens avec cette société, notamment ses médias, restent privilégiés, l’endogamie est forte ainsi que la sociabilité intracommunautaire. On a alors une simple intégration.
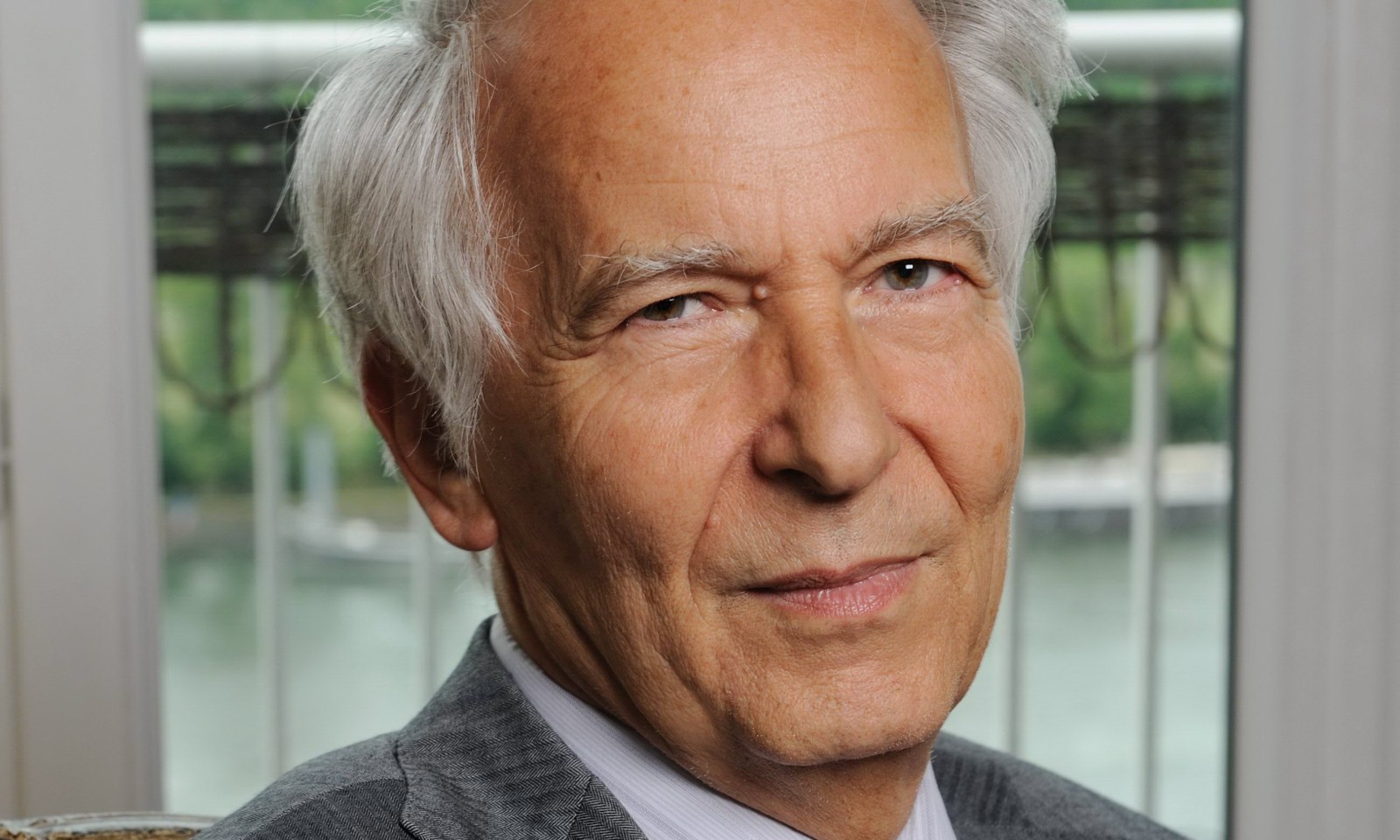
Philippe d’Iribarne est directeur de recherches au CNRS © Hermance Triay / Opale / Leemage
Une attitude plus offensive consiste à tenter d’imposer au pays d’accueil la loi qui prévaut dans son lieu d’origine. Il s’agit de s’appuyer sur l’acquisition des droits du citoyen pour agir en ce sens. Pensons par exemple à la pancarte, brandie au cours d’une manifestation : « Française musulmane voilée. Si je vous dérange je vous invite à quitté [sic] mon pays. » Dans ce propos « mon pays » ne veut pas dire le pays dont je reçois l’héritage avec gratitude, mais celui qui m’appartient comme si je l’avais conquis.
L’assimilation se situe aux antipodes de cette perspective conquérante. Il s’agit, au-delà du seul respect des lois de la société d’accueil, de devenir un membre ordinaire de celle-ci, se voulant pleinement héritier de son histoire, adoptant ses mœurs, y trouvant un conjoint et des amis en même temps qu’une identité. Jean Daniel a évoqué cette démarche, qui a été celle de sa famille : « Avec les avantages d’une citoyenneté, les nouveaux Français recevaient l’honneur d’une appartenance. […] Ils ne se demandaient pas ce que le pays leur devait, mais ce qu’ils devaient au pays. Et ce qu’ils devaient était simple : un partage de souvenirs et de projets ; une profonde adhésion aux valeurs de la société qui les accueillait ; un respect scrupuleux des valeurs, des rites et des usages de cette société .(1) »

Marche contre l’islamophobie, Paris, 10 novembre 2019. © Marie Magnin/ Hans Lucas/AFP
Des difficultés très inégales selon les pays et les populations accueillies
Une telle assimilation n’est pas seulement une question de volonté, mais de difficulté objective, qui tient à la fois aux exigences de la société d’accueil et au chemin que doivent accomplir les nouveaux venus pour y répondre.
Selon les pays, les conditions à remplir pour être regardé comme un membre ordinaire de la société sont très diverses. Ainsi, il paraît impossible d’être considéré comme un vrai Japonais si l’on n’est pas d’ascendance japonaise ; on trouve au Japon des Coréens toujours identifiés comme tels alors que leur famille vit dans le pays depuis des générations. À l’inverse, aux États-Unis, le respect de la loi, du drapeau, de l’hymne national suffit pour être considéré comme un « vrai Américain » ; diverses communautés d’origine revendiquant chacune leur propre héritage, et entre lesquelles les liens de solidarité sont relativement ténus, y coexistent, même si officiellement le principe « égaux, mais séparés » n’est plus en vigueur. On se rapproche du cas des empires où coexistent une pluralité de nations et où on a moins une assimilation à l’empire dans son ensemble qu’à une des communautés qui le composent.
En France l’idée d’assimilation est source de malaise du fait qu’elle confronte aux contradictions intimes de la société française prise entre l’image officielle qu’elle donne d’elle-même et la réalité de son fonctionnement social. Officiellement, l’appartenance à la nation est marquée par une stricte distinction entre espace public et sphère privée : « Au privé la libre expression des différences, au public l’assimilation à l’ordre politique et juridique de la citoyenneté. Au privé l’affirmation libre des identités et des références particulières grâce auxquelles l’homme donne librement un sens à son existence […], au public l’unité-égalité-universalité de la citoyenneté de l’individu.(2) » Dans cette logique, il n’est pas question d’assimilation et la constitution de diasporas au sein de l’espace privé est parfaitement admissible. Mais en pratique, la société française regorge de lois non écrites, souvent beaucoup plus respectées que ne le sont celles de la République. Ainsi, une certaine discrétion dans l’affichage des convictions politiques et religieuses est exigée comme un élément essentiel de la paix sociale. Ce qui « ne se fait pas » tient une grande place dans les rapports sociaux, y compris ceux qui relèvent de la sphère publique. La manière dont chacun est traité dans cette sphère, qu’il s’agisse du monde du travail, des rapports entre locataires et bailleurs ou même des rapports avec l’administration, dépend largement de la façon dont il respecte non seulement les lois, mais aussi les mœurs, de son degré d’assimilation. Or il n’est pas évident pour ceux qui viennent d’ailleurs de saisir la subtilité de ces codes que chacun apprend dans sa famille, sans qu’ils soient affichés nulle part, et qu’il est même offensant de rappeler à quelqu’un qui ne les respecte pas de lui-même. Cet écart entre l’officiel et l’officieux conduit nombre de ceux qui subissent des réactions de rejet, du fait de leur manque d’assimilation, à les ressentir comme discriminatoires, alors que les mêmes manières d’être susciteraient des réactions analogues, voire plus vives (car ils ne peuvent avoir l’excuse de mal connaître les codes sociaux) envers ceux qui sont là depuis des lustres (3).
Par ailleurs, dans un contexte donné, la difficulté à s’assimiler pour celui qui le souhaite dépend beaucoup du chemin qu’il a à parcourir, en fonction de l’étendue qui sépare les normes de vie auxquelles il est attaché, ses évidences familières, de celles qui prévalent dans la société qui l’accueille.
Un point épineux concerne la façon de vivre une double allégeance, à un pays et à une religion. De manière générale, il existe deux grandes manières de résoudre cette équation. La première consiste à faire allégeance à une entité d’ordre supérieur qui transcende la religion et la patrie. Victor Klemperer, juif allemand dit « assimilé », écrit ainsi dans son célèbre ouvrage sur la langue du IIIe Reich : « La véritable mission que ce Dieu a assignée à son peuple [le peuple Juif] est justement de n’être pas un peuple, de n’être attaché à aucune barrière spatiale, à aucune barrière physique, de servir, sans racine, la seule idée. » En se référant aux mêmes valeurs supérieures, en tant que juif et en tant qu’Allemand, il s’affirmait sans contradiction totalement l’un et l’autre. L’autre approche consiste à séparer les domaines de l’existence qui relèvent de la religion (la vie privée) de ceux qui relèvent d’un monde profane (l’organisation de la cité), séparant ainsi deux objets d’allégeance qui n’entrent pas en concurrence.
Dans la rencontre entre le monde musulman et l’Occident, ces deux approches font difficulté, raison pour laquelle l’assimilation des musulmans est tout sauf évidente. L’appel à des valeurs auxquelles il serait possible d’adhérer simultanément en tant que musulman et en tant qu’Occidental, dans une allégeance qui transcenderait deux allégeances partielles, ne paraît guère possible pour des musulmans conséquents. La liberté de conscience, qui est au cœur des civilisations européennes, n’est pas acceptée dans l’islam. Ainsi il n’est pas question pour celui-ci d’admettre le droit de le quitter pour une autre religion. De plus, le refus musulman de l’égalité entre hommes et femmes a un caractère d’autant plus sacré que le Coran l’érige en norme, notamment pour affirmer qu’un homme vaut deux femmes en matière d’héritage (Cor IV 11). Quant à la distinction entre une sphère profane, où il convient de se conformer aux usages de la société environnante, et une sphère religieuse, elle est également problématique, tant l’islam est dès l’origine un mouvement politico-religieux. Dès lors que les préceptes religieux régissent des domaines tels que la nourriture et le vêtement, on voit mal comment un musulman conséquent pourrait accepter les normes profanes dans ces domaines.
Cette difficulté à être simultanément en harmonie avec les orientations du monde occidental et avec celles de l’islam est à la source de profondes fractures parmi les Français musulmans. Une partie significative d’entre eux (environ 15 %(4)) privilégie une perspective d’assimilation, mais quitte l’islam, ou du moins se contente de quelques pratiques qui ne concernent que leur vie privée. D’autres, au contraire, privilégient l’islam et rejettent la société française, dans une perspective conquérante ou au moins de diaspora. Ainsi, dans un sondage parmi les musulmans de France réalisé en août 2020 à l’occasion du procès de Charlie Hebdo, ils ont été interrogés sur la proposition « L’islam est incompatible avec les valeurs de la société française ». Près d’un tiers (29 %) a répondu par l’affirmative (36 % chez les hommes, 23 % chez les femmes), mais cette proportion s’élève à 45 % chez les moins de 25 ans. De même, 56 % des musulmans, contre 5 % de la population générale, approuvent la proposition « Une femme doit obéir à son mari »(5). On comprend mieux que ceux qui cherchent à être à la fois de bons musulmans et de bons Occidentaux peinent à y parvenir.
À ces difficultés structurelles de l’assimilation, il faut ajouter une dimension sociale. En France, parmi les immigrés originaires de l’ex-empire colonial, certains, issus de famille qui appartiennent, dans leur pays d’origine, à la bourgeoisie intellectuelle ou aux milieux d’affaires, possèdent déjà toute une familiarité avec des habitus français. Il n’en va pas de même pour ceux qui sont issus de milieux modestes ou ruraux. Certains, parce qu’ils ont une farouche volonté d’assimilation, y parviennent, sinon pour eux pour leurs enfants. Beaucoup pourrait être fait pour les y aider en leur permettant de mieux décrypter les exigences de leur société d’accueil.